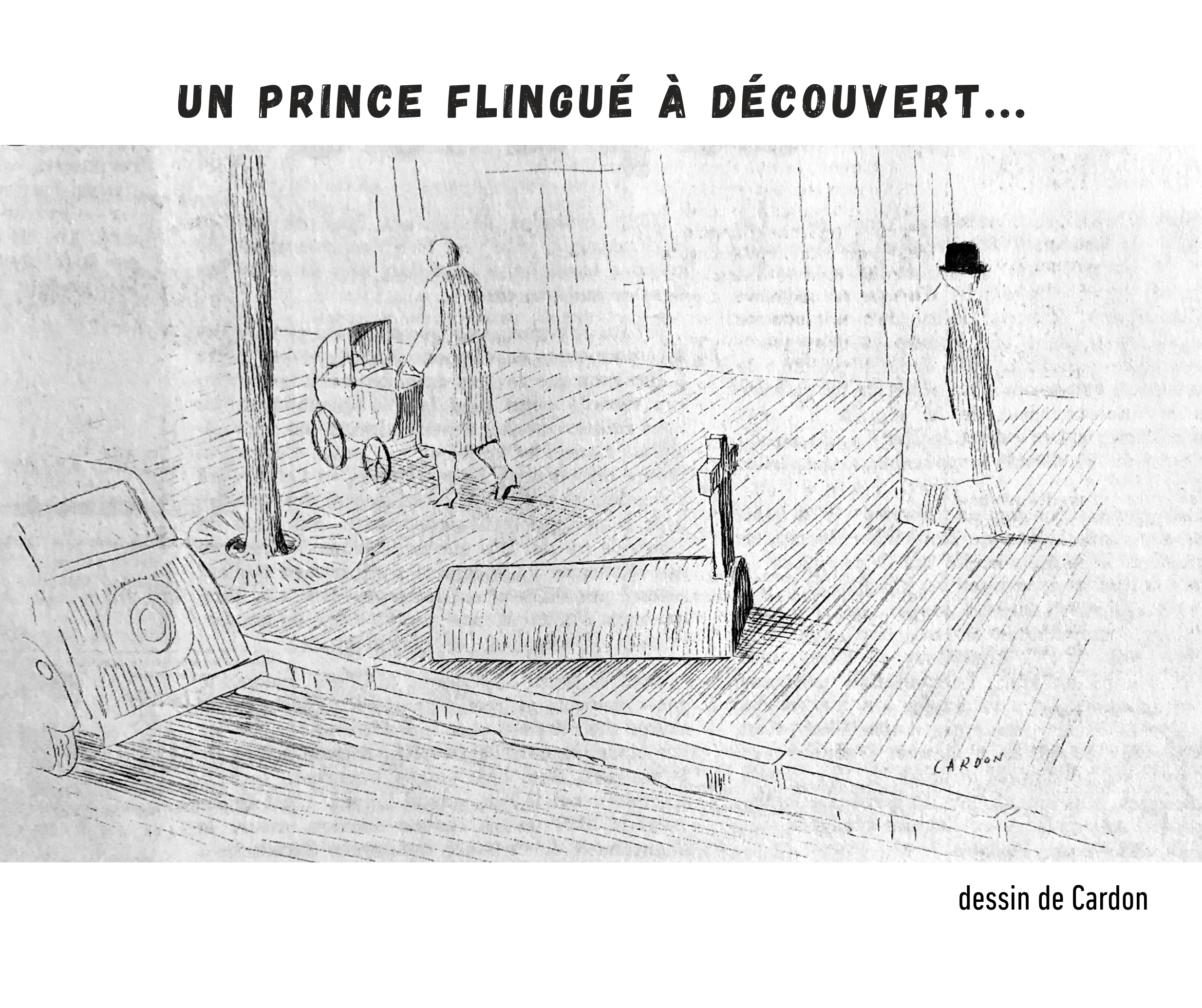Paris, 2 rue des Dardanelles, vendredi 24 décembre 1976, 9 heures 22.
Le prince Jean de Broglie,
55 ans, député de l’Eure, est abattu de 3 balles de calibre 38 Special, comme un vulgaire malfrat, en sortant du domicile de Pierre de Varga, son conseiller fiscal. Plusieurs fois secrétaire d’Etat de 1961 à 1967, ex-conseiller d’Etat, Jean de Broglie est une figure de la Vème République et son assassinat devient une affaire d’Etat montrant le septennat de Giscard d’Estaing sous son jour le plus sombre. Cinq jours seulement plus tard, lors d’une conférence de presse surréaliste, le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, flanqué du patron de la police judiciaire, Jean Ducret, et du chef de la brigade criminelle, Pierre Ottavioli, déclare l’affaire résolue : Jean de Broglie a consenti un prêt de 5 MF à Patrick Allenet de Ribemont, pour l’achat de la rôtisserie La Reine Pédauque; Ribemont et Pierre de Varga, un ancien gestapiste qui a mêlé le prince dans ses investissements troubles, sont désignés, sans preuves, comme les commanditaires de l’opération, visant à éliminer de Broglie pour effacer le prêt. Sont aussi arrêtés le tueur à gages, Gérard Frêche, et l’organisateur, un inspecteur de police, Guy Simoné.
Mais une telle précipitation, au mépris du secret de l’instruction, confiée au juge Guy Floch, est suspecte et, dès le 29 décembre, Nicolas Brimo écrit un article dans le Canard enchaîné révélant que le prince avait ajouté, ces dernières années, à ses relations du Bottin mondain d’autres fréquentations moins avouables et qu’il se livrait à des activités commerciales douteuses, notamment via une société spécialisée dans le trafic d’armes à destination des pays arabes. Puis l’intérêt pour l’affaire retomba.
L’affaire revient sur le devant de la scène en avril 1980, avec la fin de l’instruction et l’ouverture du procès des inculpés. Le 2 avril, Le Canard révèle l’existence de 2 rapports rédigés en avril et en septembre 1976 par un inspecteur de police, Michel Roux, de la 10ème brigade territoriale, renseigné par l’indicateur Albert Leyris, montrant que la police était au courant de menaces pesant sur la vie du prince d’une part, et qu’il était question d’un projet de trafic de faux bons du Trésor, d’autre part. Rapports dûment transmis par l’inspecteur à sa hiérarchie, mais qui se garda bien, elle, de les transmettre à la justice. Pourquoi ? Et pourquoi avoir cessé de protéger le prince ? Poniatowski nia avoir jamais eu connaissance des 2 rapports et poursuivit le Canard en diffamation.
Dans le numéro 3102 du Canard enchaîné, paru le 9 avril 1980, on peut lire : « Deux ans avant d’être assassiné, Jean de Broglie avait déjà reçu des menaces et des policiers s’étaient vus alors chargés d’assurer sa protection. C’est l’une de ses amies, Mme Chédeville, qui l’a confié au juge Floch, au cours de l’instruction […] Ces menaces émanaient, selon les enquêteurs, d’anciens harkis qui voulaient se venger de Jean de Broglie, l’un des négociateurs français des accords d’Évian. Les flics ouvrirent donc l’œil. Rien de plus normal, d’ailleurs, que cette sollicitude policière : fondateur avec d’autres et longtemps l’un des financiers du parti giscardien, associé des hommes d’affaires de l’Opus Dei, » la Sainte Maffia » si chère à la famille Giscard, et lointain parent d’Anne-Aymone, Jean de Broglie n’était pas n’importe qui ».
Malgré ces révélations, les autorités judiciaires ne remirent pas en cause la thèse officielle de 1976 et Poniatowski fut innocenté par la commission d’enquête parlementaire en novembre 1980. Parvenus au pouvoir en mai 1981, les socialistes, si prompts à réclamer des investigations supplémentaires lorsqu’ils étaient dans l’opposition, se gardèrent bien de remettre le dossier sur la table. Idem avec Robert Badinter, nouveau garde des Sceaux, lui qui fut le 1er avocat de la famille de Broglie. Ce fut ainsi « le deuxième enterrement de l’affaire de Broglie, la plus ténébreuse et la plus crapuleuse des affaires du giscardisme », conclut Roger Fressoz.
Gérard Frêche, le tireur, écopa de 10 ans de prison, tout comme Guy Simoné, qui, blanchi, réintégra même la police en 1988, 5 ans après sa sortie. De Ribemont, désigné « commanditaire présumé » publiquement par Poniatowski, est d’abord condamné à 18 mois de prison puis obtient un non-lieu et 2 MF de dommages et intérêts, octroyés par la Cour européenne des droits de l’homme, pour violation du principe de la présomption d’innocence. Pierre de Varga prit aussi 10 ans, mais fut choyé par l’administration pénitentiaire, disposant de deux cellules, dont une lui servait d’atelier de peinture…
SP